 |
Figures
de proue du cinéma expérimental, initiatrices du «cinéma
corporel» et protagonistes des environnements de projection, instigatrices
d'approches novatrices de la photographie et pionnières du croisement
des média, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki démontrent
par la rigueur de leur engagement personnel, comme par leur démarche
qui se développe en longs cycles, la nécessité de
repenser la création contemporaine à la lumière des
nouveaux outils technologiques, mais aussi à celle des préoccupations
scientifiques, sociales et philosophiques actuelles.
|
Etudiantes, en Grèce, sous le régime
des colonels, Maria Klonaris et Katerina Thomadaki raniment le théâtre
moribond à grands renforts de mises en scène plastiquement
assumées et brisent les garde-fous des corps trop bien cadrés
par la scène en montant Salomé d’Oscar Wilde ou Les
Bonnes de Genêt. Quand les consciences les plus créatives
de leur génération se font massacrer dans le sanctuaire démocratique
de l’Ecole Polytechnique, leur engagement est tracé. Elles décident
de participer au grand moratoire des mythes engagé en ces années
70. Elles emportent en France les traces des bandeaux noirs de la censure,
les cicatrices mentales des deuils jamais faits, le répertoire épuré
des grandes fables matriarcales et l’idée d’un théâtre
de lumière à traduire dans d’autres langues technologiques.
Leur première action parisienne, collective, La Torture mise
en corps, est accueillie au Théâtre de l’Epée de
Bois (Cartoucherie de Vincennes, 1976). Elles exposent leurs corps dans
la mise en scène dépouillée de la torture dénoncée,
opposent gestes répétitifs et immobilités maîtrisées
en une suite cohérente de privations sensorielles. Elles font vite
l’économie de leurs autres partenaires de cette action puisque leurs
deux corps suffisent à bâtir la scène essentielle de
leur travail, un double labyrinthe
Un cinéma
corporel
Dans leur premier film "intercorporel",
Double
Labyrinthe (1976), on les voit mener réciproquement six
actions avec des matières et six avec des objets à la symbolique
cosmique. Elles inventent ainsi le croisement des regards, l'échange
des rôles entre sujet filmant et sujet filmé
et esquissent une théorie alternative du regard en cinéma,
selon le principe de «la femme comme sujet», plus avancé
au plan politique qu’artistique à l’époque. Le montage symétrique
des deux séries d'actions contraint le spectateur à construire
ses propres liens. Il participe à l’élaboration d’une langue
des corps–images. Ce premier volet de leur Tétralogie
corporelle (1976-79) se trouve ainsi à l'origine d'un des
plus remarquables mouvements du cinéma expérimental récent,
celui qui s'est construit autour du corps et du Super 8 en France d'abord,
puis en Angleterre et en Allemagne.
Unheimlich II:
Astarti (1980), autre film culte, réactualise une mythologie
des origines. Sa figure tutélaire est perturbée par les sentiments
de l’inquiétante étrangeté énoncés par
Freud et qui constituent le titre emblématique du Cycle
de l’Unheimlich (1979–81). Partir sur les traces d’Astartée
permet l’entrée dans une durée dilatée, diffractée
par le silence du film, ouatée autant par le fond noir de l’image
que par la rigueur des coupes cut. Pour donner corps à la déesse
lunaire du bassin méditerranéen, elles sont trois "actantes"
évoluant dans un film de trois heures. Les projections sur leur
corps-écran actualisent l’archétype, le promènent
entre ses avatars terrestres et des versions célestes à la
laitance boueuse. S’extrayant d’un brasier visuel de cicatrices, les actantes
traversent tous les règnes, de la naissance à la mort, en
une archéologie du vivant.

Installant un cadre bâti d’obscurité,
Klonaris et Thomadaki disposent, dans le noir d’un cinéma onirique,
des écrans de toutes natures qui stigmatisent des possibles. Les
écrans se font miroirs et les miroirs écrins d’images. Le
corps des artistes n’est ici qu’un piège: de l’inquiétante
étrangeté des lieux , le spectateur doit comprendre que son
inconscient est meilleur conseiller. Pensant échapper à l’emprise
du noir dans la réalité des images, il sera confronté
à sa propre «tétralogie corporelle».
Unheimlich III:
Les Mères (1981), la
performance constituée de projections d'une singulière complexité
créée pour le cinéma du Musée du Centre Pompidou,
préfère au fond noir la découverte de paysages solaires
où dedans et dehors se confondent. Des figures féminines
hantent les ruines et les mers grecques se réfractant dans l'espace
inondé d'images immatérielles. Une dizaine de projecteurs
de film et de diapositives, ainsi que des écrans préparés,
mobiles, sont manipulés par les deux artistes qui revendiquent une
«corporalisation de la projection». Cette cartographie mouvante
fait naître le théâtre de lumière qui contient
et immerge le spectateur et s'affirme en tant que dispositif matriciel.
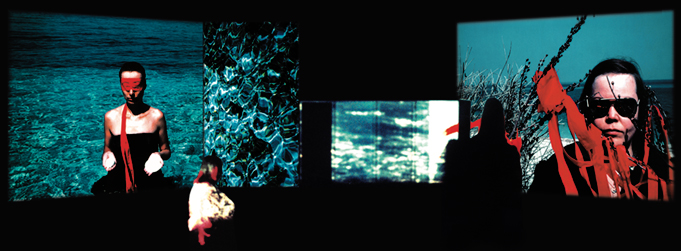
Un dialogue interdisciplinaire entamé
avec la pensée de Freud et de Jacques Lacan constitue le pan théorique
de cette proposition en œuvres (participation à un cartel de la
Cause Freudienne, 1980-81). Le concept Lacanien de l'inconscient comme
langage trouve de surprenants parallèles visuels dans une œuvre
qui peut aussi apparaître comme le contrepoint, non illustratif mais
incarné, des avancées théoriques sur «le féminin
comme inconscient» développées par Luce Irigaray. Dans
une anticipation spectaculaire étant donné les idées
politiques de l'époque autour de l'identité sexuelle, du
féminin elles se tournent vers l'hermaphrodite et esquissent, en
pionnières encore, un discours iconique de l'intersexualité.
|

Univers intersexuel
Mystère I:
Hermaphrodite endormi/e, l'environnement de projection très
remarqué à la XIIe Biennale de Paris de 1982, apparaît
aujourd'hui comme une œuvre phare dans l'histoire récente de la
projection. Le grand interlocuteur est ici l’hermaphrodite du Louvre dont
les artistes tirent diverses images transparentes qu'elles installent au
cœur du dispositif. Les trois salles offrent dans leur succession autant
d’étapes à une quête amoureuse refondée en autant
de rituels. La prise de vue s’est attachée à traduire l’immatérialité
du marbre, effet renforcé par la création sonore, au sein
de l’IRCAM et de Radio France, où des voix d'enfants soprano et
de haute contre, jouent avec les boucles musicales. Ces dernières
trouvent leur traduction plastique dans les écrans circulaires et
les boucles de films. Des écrans de tulle, positionnés en
deçà et au delà des surfaces de projection, restituent
une troisième dimension à la sculpture antique magnifiée
par la lumière. Cependant les corps réels des spectateurs,
leur ombre projetée, altèrent la pureté de l’image
en la restituant dans notre époque. A la distanciation de la bande-son
enregistrée répond la présence d’une violoncelliste
dans l’installation. Là encore la quête labyrinthique se met
au service d’un dialogue des arts et produit un effet puissant d'immersion
polysensorielle, préfigurant des recherches postérieures
en réalité virtuelle.
Vers un angélisme
militant
Depuis L’Enfant
qui a pissé des paillettes (1977) et jusqu’au Cycle
de l'Ange (1985-...), les deux artistes construisent le théâtre
hologramme des aventures politiques d’êtres intermédiaires.
Comme dans toute célébration, un cérémonial
se construit autour d’une icône sujette aux plus diverses interprétations,
ici technologiques. Dans Le Cycle de l’Ange, une image médicale
d'hermaphrodite subtilisée au père gynécologue de
Maria fait l’objet d’une première matrice photographique qui subit
un ensemble de traitements optiques ou numériques, traversant l’histoire
du multimédia. Cette hermaphrodite, femme au corps d’homme, peut
se lire aujourd’hui comme le prototype de toutes ces expériences
artistiques sur le transformisme et le clonage, à la différence
(majeure) qu’un être réel se trouve à son origine.
Le professeur Henri Atlan, dans un récent colloque sur «l’art
de cloner» organisé par l’Ecole doctorale de Paris I, rappelait
qu’à la place du terme vague de clonage, issu des médias,
les scientifiques préféraient l’expression «reconstitution
d’embryon par transfert de noyau». Cette définition semble
qualifier la démarche de Maria Klonaris et Katerina Thomadaki. En
avance sur les expériences scientifiques et parallèles à
celles-ci, les doubles de "l'Ange", multipliés à l'infini,
sont bien le produit de clonages technologiques dits aussi reproductifs.
Avec Le Cycle de l’Ange, la topologie
du double labyrinthe se complexifie. Il est parfois plus difficile d’en
saisir les voies à la fois plus imbriquées et plus éclatées,
car les deux artistes interviennent dans la multiplicité des technologies,
comme dans la diversification et l’extension des espaces de l’œuvre. Requiem
pour le XXème siècle (vidéo, 1994) a pour
cadre la guerre dont l’hermaphrodite se fait l’ange-miroir. Tour à
tour victime et témoin à charge, l’ange dédoublé
y brûle des lumières de sa propre douleur selon la litanie
tragique du siècle égrenée au générique:
«l’étranger-e / le témoin / la victime / le juge /
corps de la différence / corps de l’holocauste / corps irradié
/ il/elle l’Ange». Ce crédo victimaire énonce le corpus
politique des anges.
Il ne faudrait pas croire qu’on peut interpréter Le
Cycle de l’Ange comme une simple hagiographie de la différence.
Notamment parce que le projet dresse autant «une cosmogonie incarnée»,
qu’un réel horizon politique pour ces êtres intermédiaires.
Le travail côtoie aussi, sans intervenir sur le même territoire,
des recherches artistiques sur les limites corporelles, comme celles d’Orlan
ou de Stelarc (révélé au public parisien par A.S.T.A.R.T.I.,
en 1994). Cet horizon idéologique s’est établi également
par confrontation constante aux imaginaires turbulents des mouvements sociaux
de subversion de l'identité sexuelle.
Mutation
siamoise
Avec Désastres sublimes (cf.éditions A.S.T.A.R.T.I., 2000) s’amorce
le cycle le plus récent, celui de la gémellité siamoise,
qui recoupe intuitions scientifiques et avancées plastiques. Si
l’hermaphrodite peut exercer une attirance avec son ambiguïté
sexuelle, la figure des siamois semble plutôt liée à
une étrangeté qui interroge nos certitudes sur l’unité
individuelle. En cela, elle nous confronte aux catégories du monstrueux
que la société a exploité du vivant des siamois. En
les rapprochant, à l’aide l’ordinateur, des planches biologiques
d'Ernst Haeckel, Klonaris et Thomadaki présentent les différentes
versions des jumeaux accolés par la taille comme autant de clones
célestes. Leur filiation angélique se lit surtout sur la
douceur de leurs visages peu marqués par la différenciation
sexuelle. Ils apparaissent ainsi comme les anges marginaux d’un destin
douloureux, stigmatisés par une société où
le spectacle de l’exclusion conforte la normalité. Le projet des
artistes ancre cette dimension engagée dans les marges d’une normalité
identitaire et pourrait se lire, cette fois-ci, comme un clonage thérapeutique,
où la dimension réparatrice reste essentielle. |
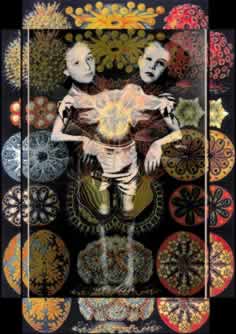 |
Cosmogonies angéliques
L’hypothèse, une fois acceptée,
d’une organisation gémellaire de type labyrinthique, ne suppose
qu’une approche horizontale des cycles . Elle ne tient pas compte de cette
organisation vers le haut qui met en place ciels et constellations depuis Unheimlich
I: Dialogue secret(1979) jusqu’à l’univers des siamois,
«des astres sublimes». Cette volonté d’installer et
d’incarner une cosmogonie pour l’ensemble de leur univers cyclique se manifeste
puissamment dès que la créativité de Klonaris et Thomadaki
investi un lieu. Pour que l’espace que les artistes offrent à ces
figures de la transgression ne coure pas le risque d’intégrer celles-ci
dans de nouvelles normes, il leur faut accéder à une autre
dimension, plus spirituelle encore, dans un lieu chargé de mémoire.
Cette dimension peut être forte d’une charge artistique comme lorsque
Madeleine Van Doren les invite à concrétiser Le
Rêve d’Electra en 1987 dans la galerie Edouard Manet à
Gennevilliers. Le lieu investi peut aussi posséder une mémoire
du corps, à l’instar de cette piscine londonienne où est
mis en scène le Night Show for Angel pour la biennale Edge en 1992. Investissant les trois étages du
bâtiment de 3000m2 de la piscine désaffectée, cette
installation monumentale immerge le spectateur dans un univers qui se constitue
"derrière les paupières closes de l'Ange". Les artistes parviennent
à la transformation fantasmatique du lieu par une surenchère
technologique maîtrisée: son quadriphonique, fondus d’images
générés par ordinateur et colonnes de moniteurs vidéo.
Dans le bassin, les territoires de l’Ange se mesurent par les grands tirages
photographiques installés au sol à proximité de bols
de feu, et par le flux d’images projetées et vidéotées.
Son champ spectaculaire est borné par un triangle de gardiens animaux
extraits du bestiaire sauvage: tigres et léopards embaumés
évoquent la frontière incertaine entre l'animé et
l'inanimé.
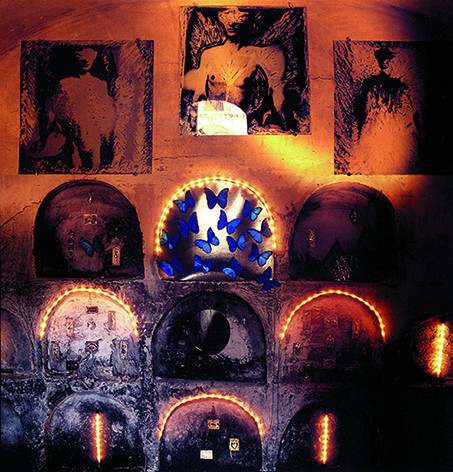 |
|
Klonaris et Thomadaki
n’hésitent pas non plus à affronter le lourd passé
d’une crypte médiévale attenante à la Cathédrale
San Isidro de Madrid pour ouvrir l'autre installation monumentale, La
Puerta del Angel, sur leur ciel reconstitué. Pour cela elles
s’assurent la complicité du fils du Greco, apparaissant dans son
tableau L’Enterrement du Comte Orgaz. Retravaillé photo-graphiquement,
le garçon est suspendu au dessus du puits octogonal de la cour.
Le sol de la crypte recouvert de miroirs, le X tracé en dalles de
miroirs autour du puits, sont autant d’entrées vers le labyrinthe
où scintillent ex-voto grecs, cristaux, lys et papillons bleus du
Brésil en un diorama étourdissant. Dans cette totale perception
kinesthésique s’entame le dialogue avec les morts des niches murales
de la crypte. |
Observatoire des
nouveaux médias
Et puisque tout fonctionne en miroir dans
ce projet de création commune, durant la constitution du vaste ensemble
d'œuvres qui compose Le Cycle de l'Ange, Maria Klonaris et Katerina
Thomadaki entreprennent, dans le prolongement de leur pratique, un travail
de réflexion inédit sur la scène internationale des
arts technologiques, les Rencontres Internationales
Art cinéma / vidéo / ordinateur d’A.S.T.A.R.T.I.
accompagnées par des publications à partir de 1990. Elles
se dotent ainsi d’un observatoire des nouveaux médias, où
se forge une théorie critique des technologies en art, où
se constitue aussi une communauté de créateurs qu’elles invitent
à partager leur projet transmédiatique et transculturel.
Les acteurs les plus prestigieux de la scène internationale y participent.
Historiquement, c’est la première tentative de réunion de
tous les médias de l’art en mouvement en un corpus commun, et ceci
à travers une lecture diachronique. La revendication d'une «écologie
des médias», le rapport entre «technologies et imaginaires»,
les «mutations de l'image» sont les territoires respectivement
explorés par les trois éditions de ces Rencontres.
Ainsi dans le refus des normes technologiques,
langagières ou sexuelles comme dans l’échappée verticale
de ces figures transgressives, se construit le double destin politique
des anges, dans une nouvelle «écologie des média».
Christian Gattinoni
Christian Gattinoni est producteur
Indépendant pour France Culture, co-organisateur des Semaines Européennes
de l’Image et membre de l’Association Internationale des Critiques d’Art.
Paru dans ART PRESS, # 275,
janvier 2002 |
|